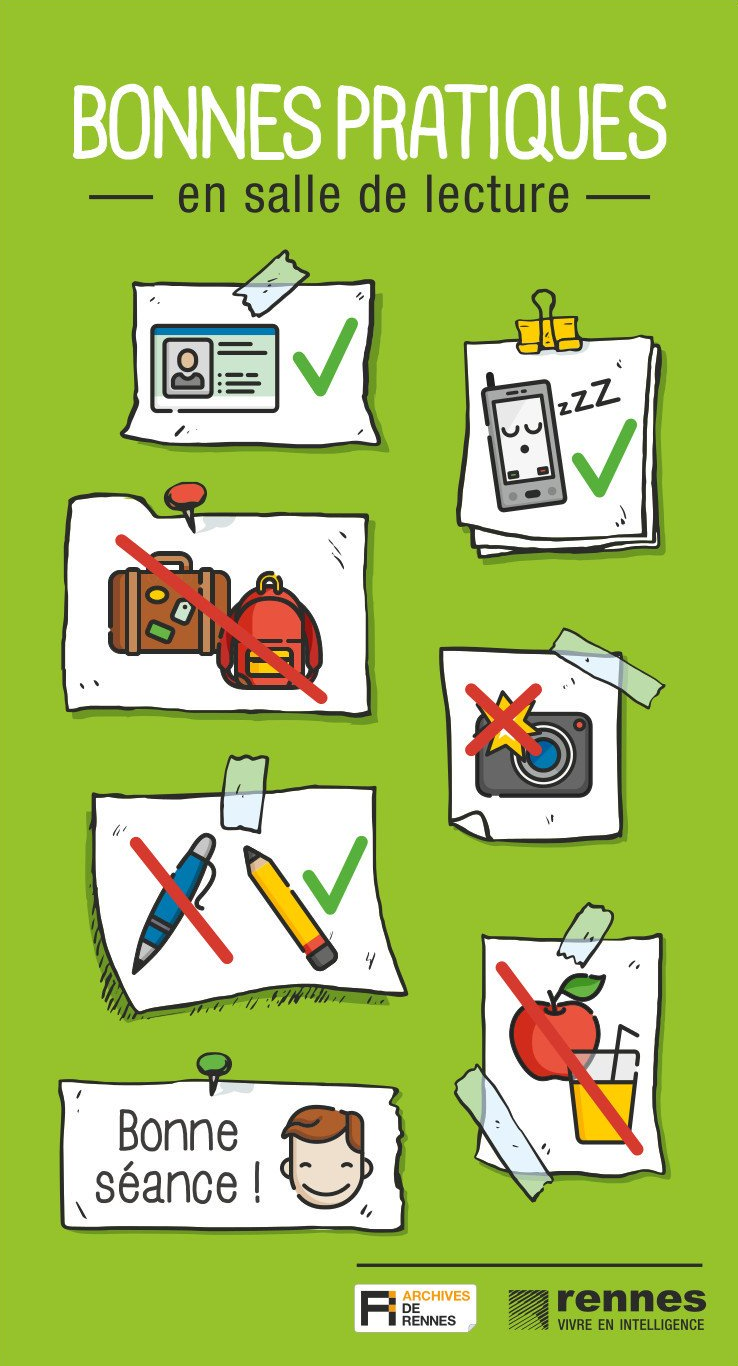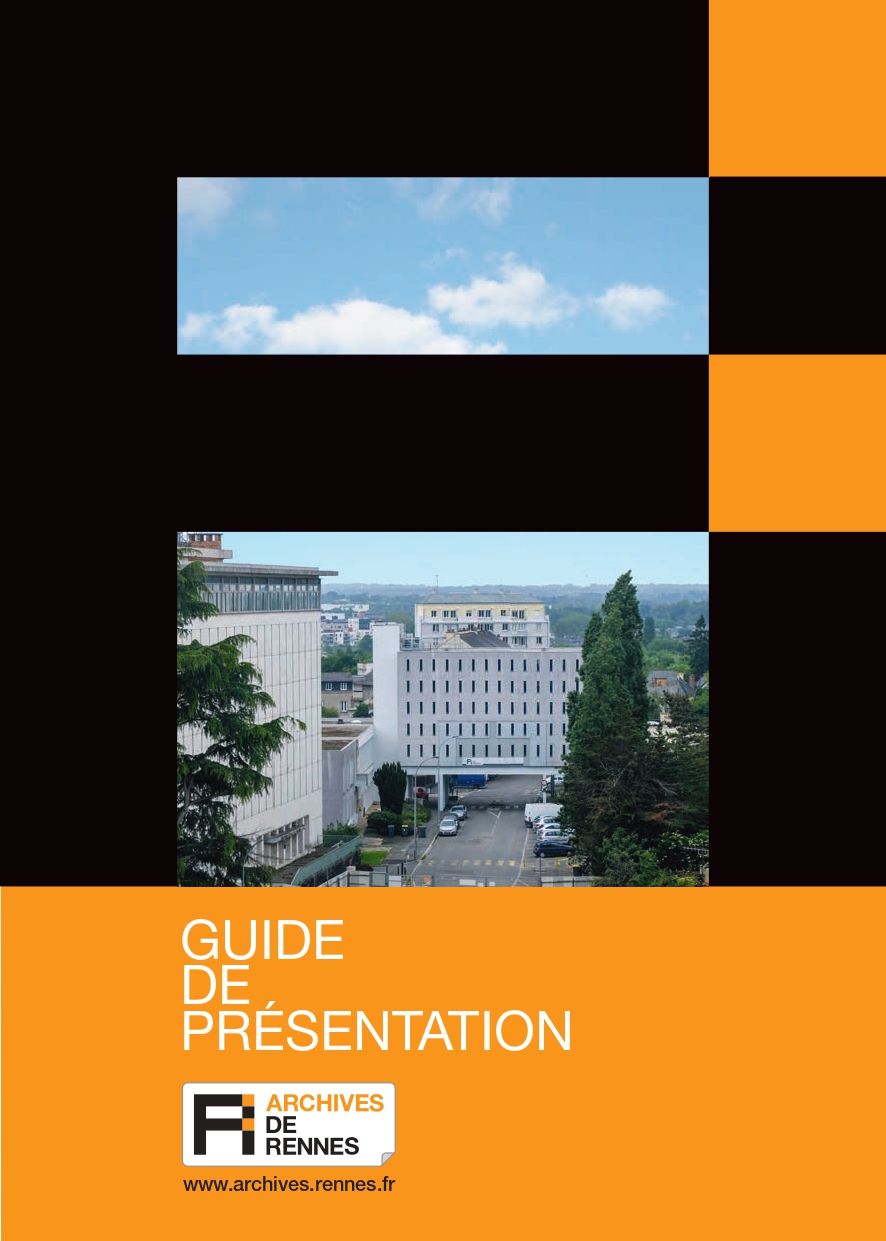Chargé des cessions de droits d'auteur. Les débuts d'une profession ?
Le 02/07/2021 EnPERSPECTIVE
À l'heure du big data et de l'ouverture des données publiques, les services d'archives mènent une politique volontariste de numérisation et de diffusion en ligne des documents qu'elles conservent.
Si plus de 400 millions de documents numérisés sont déjà accessibles gratuitement sur Internet (première ressource culturelle en ligne après l'audiovisuel), cette masse ne représente encore que la face émergée de l'iceberg !
Cette diffusion accrue des ressources culturelles ces dernières décennies est due à :
- l'encadrement juridique de l'ouverture des données, qui a vu le jour en France à la fin des années 1970 ;
- une politique de numérisation soutenue par les politiques publiques à partir des années 1990 ;
- la volonté de mise en partage des établissements culturels pour favoriser les nouveaux usages numériques et les pratiques collaboratives.
L'ouverture des données administratives et culturelles
Longtemps exonéré de l’obligation juridique de mise à disposition et d'ouverture des données, au titre du régime dérogatoire des données culturelles, selon la loi CADA (Commission d'accès aux documents administratifs) du 17 juillet 1978, le ministère de la Culture fait figure d'avant-garde dans le domaine de l'ouverture et du partage des données.
Dès 1975, le ministère inaugure la base de données Joconde, répertoriant sous un catalogue numérique un ensemble de collections issues des musées de France, notamment celles pour lesquelles les droits d'auteur sont tombés dans le domaine public. La loi Lemaire de 2016 est venue légiférer sur les licences qui peuvent être utilisées dans le cadre de l'ouverture des données produites et conservées par les administrations publiques. Deux licences sont reconnues dans ce cadre :
- La "Licence Ouverte / Open License" créée par la mission interministérielle Etalab en 2017 qui constitue la licence de référence pour la publication de données publiques de l'administration française ;
- L'Open Database License (ODbL) créée pour les bases de données par une association à but non lucratif promouvant les contenus culturels, et en particulier les contenus culturels libres.
La numérisation
Si la numérisation des documents a connu un réel accroissement en France depuis les années 1990, notamment grâce au plan national de numérisation lancé par le ministère de la Culture, elle se limite encore à certains fonds très demandés : registres d'état civil, registres de délibérations, plans cadastraux, cartes postales, etc.
Cette limite s'explique par les obligations qu'impliquent la réutilisation et la mise en ligne de certains documents. Elle est d'une part largement conditionnée par des questions de communicabilité des documents, ainsi que par des questions de droits de propriété intellectuelle (droits d'auteur et droits voisins).
La prise en compte de ces questions est devenue nécessaire afin de répondre à ces nouveaux enjeux d'accessibilités aux ressources culturelles.
De nouveaux métiers à inventer
Les pratiques de réutilisation des documents patrimoniaux par les publics ont été largement bouleversées ces dernières années par le développement du web 2.0, puis 3.0. Ces développement ont permis une diffusion sans pareil des fonds à l'échelle planétaire. Ils ont mis en lumière de nouvelles problématiques nécessitant de sensibiliser et d'acculturer les publics et les professionnels aux questions des droits, souvent peu connues.
Ainsi, l'identification des droits, qui s'appliquent aux documents, et des auteurs, ou de leurs ayants droit, afin de contractualiser avec eux le cadre dans lequel s'inscrit la réutilisation des documents conservés, constitue un enjeu majeur.
De nouveaux métiers sont à inventer pour répondre à ce besoin. Une approche pluridisciplinaire au carrefour des sciences sociales, de la recherche et du droit.
Il n'existe à ce jour aucune formation diplômante pour devenir "chargé de gestion des cessions des droits d'auteur". Ce métier, si tant est qu'il ait une appellation officielle, demande des compétences en médiation, en méthodologie de recherche, des connaissances juridiques, une certaine rigueur, le sens et le goût pour la communication.